Par Marie Saydeh, Doctorante à l’Université Laval
Une discussion avec des personnes qui pratiquent la recherche multidisciplinaire impliquant l’étude de sociétés humaines et la gestion de ressources naturelles.

Qu’est-ce que la recherche multidisciplinaire ?
Tout simplement, c’est d’utiliser diverses spécialités en parallèle au cours de la réalisation d’un projet scientifique. Pour mon doctorat, je fais intervenir différentes disciplines afin de répondre à ma question de recherche. Pour le pitch explicatif de mon projet, je dis souvent que je fais de la recherche en socioécologie et en gouvernance environnementale. À première vue, ce sont des sujets qui ont l’air fascinants ! Mais, d’un autre point de vue, je me dis que cette explication doit être énigmatique et légèrement spécifique.
En pratique, je suis amenée à maîtriser des notions d’anthropologie, de géographie humaine, de biologie, d’agroforesterie, de psychologie, des sciences politiques… Bref, j’élabore un vrai bricolage disciplinaire !
Avec mes collègues de l’Université Laval, des personnes aux cycles supérieurs et des professionnel.le.s de recherche, nous sommes plusieurs à faire de la recherche scientifique multidisciplinaire sur des thèmes impliquant l’étude de sociétés humaines. Pour la rédaction de cet article, j’ai voulu m’intéresser à nos expériences et j’ai demandé à ces collègues volontaires de remplir un questionnaire de 15 questions. Je vous partage dans les lignes qui suivent, les résultats et des réflexions personnelles sur le sujet.
Quel est le rapport de mes collègues à la recherche multidisciplinaire en milieu académique ?
Selon les résultats obtenus, mes collègues effectuent de la recherche impliquant diverses disciplines dès la conception de leur projet et dans l’analyse des données. Ceci leur permet de répondre adéquatement à une question de recherche, impliquant l’étude de sociétés humaines dans la gestion de ressources naturelles.
Je me suis ensuite intéressée à leurs perceptions des systèmes de financement à l’égard de la recherche concernée. Les personnes ont plutôt des impressions dans les tendances négatives. Iels ont mentionné que « parfois », voire « aucunement », ce type de recherche était favorisé.
Je leur ai également demandé quels seraient les types de recherche qu’iels voudraient pratiquer dans un monde idéal où les ressources leur seraient accessibles. 33,3 % demeureraient dans le multidisciplinaire, tandis que 55,5 % iraient vers le pluridisciplinaire (utilisation de différentes expertises vers un objectif commun) ou le transdisciplinaire (connaissances formulées au-delà de disciplines strictement distinctes).
Les valeurs personnelles des chercheur.euse.s, ont-elles un rôle à jouer ?
J’ai demandé à mes collègues s’iels aimaient faire de la recherche multidisciplinaire. 83 % ont répondu que oui. Les 17 % restants ont justifié des éléments qui, selon moi, touchent à des notions qui mériteraient d’être approfondies ultérieurement. Certain.e.s ont répondu qu’iels préféreraient travailler dans une seule discipline. D’autres voudraient plutôt faire de la recherche transdisciplinaire, c’est-à-dire d’intégrer des connaissances au-delà de la division de certaines disciplines.
Je me demande donc : existerait-il un besoin, chez les chercheur.euse.s concerné.e.s, de décloisonner des connaissances, ou du moins de reconnaître ce type de recherche dans sa valeur intégrale ? Pour le milieu académique, la recherche multidisciplinaire n’agirait-elle pas parfois comme un compromis vers la transdisciplinarité ?
J’ai aussi demandé à mes collègues si la motivation personnelle jouait un rôle important dans la pratique de cette recherche. 55 % des collègues ont répondu qu’il faut être « motivité.e » ou « passionné.e » pour pouvoir pratiquer la recherche multidisciplinaire en lien avec les sociétés humaines. Or, 33 % ont répondu « pas forcément ». Le 11 % restant, à ma grande surprise, n’ont pas répondu à la question.
Je me suis donc demandé quelles étaient les motivations personnelles ou professionnelles de mes collègues. 88 % ont répondu que ce qui les motive à pratiquer, c’est, entre autres, de savoir que leurs recherches pourraient être utiles pour la société. D’autres motivations sont ressorties également, comme le fait de répondre rigoureusement à une question scientifique, de réussir à faire avancer un projet, de suivre le courant de la vie académique et même de se challenger personnellement.
À quoi sert la recherche multidisciplinaire ?
Lorsque j’explique ma recherche, je me retrouve systématiquement à devoir rendre accessible de nombreuses notions afin que mes interlocuteur.rice.s puissent à leurs tours suivre mes développements. Autrement dit, je dois aller rejoindre les personnes dans les concepts qu’elles connaissent pour exposer avec succès le sens de mes réflexions.
C’est dans ce sens que je me dis que c’est sûrement le rôle de la recherche multidisciplinaire, que de rejoindre les personnes dans les contextes qui les concernent ; tout comme de s’inscrire dans une situation vécue. Je me demande donc si le fait de pratiquer la recherche multidisciplinaire n’amène pas aussi à développer une expertise particulière; la capacité de naviguer entre les disciplines et d’entamer des discussions avec des divers acteur.rice.s, rejoignant des connaissances qui resteraient autrement isolées dans le vase clos d’une discipline.
La recherche multidisciplinaire impliquant l’étude de sociétés humaines, selon moi, sert à ce que les résultats s’inscrivent dans une situation authentique et que potentiellement ils puissent contribuer à fournir des informations utilisables aux personnes concernées par un enjeu.
Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues de l’Université Laval qui ont répondu au questionnaire ou qui ont contribué à cette discussion avec moi. Je remercie, entre autres, Victor Beaudet, Yann Miassi, Mohamed Awalo Traoré, Benjamin Roy, Denis Blouin, Dieu Merci Domboli, Emmanuel Lokpaka Bafalata, Anne Bequeret et Alice Semnoun.

À propos de l’auteure : Marie Saydeh est candidate au doctorat en géographie à l’Université Laval. Elle a obtenu une maîtrise de l’Université de Sherbrooke et de l’Université de Liège en sciences et gestion de l’environnement, ainsi qu’un baccalauréat en biologie de l’Université d’Ottawa. Elle s’intéresse aux questions de nature transdisciplinaire et son projet de doctorat porte sur les constructions sociales de la biodiversité dans les actions publiques en agroenvironnement au Québec. Elle étudie comment s’organise la gestion de la biodiversité en agroenvironnement au Québec.
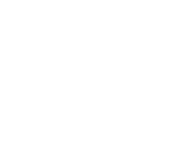
0 Comments